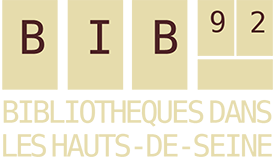Le point sur... : les documents sensibles en bibliothèque
Cette matinée a eu lieu le jeudi 20 mars 2025 à la Médiathèque Anne Fontaine d'Antony et était animée conjointement par Dominique Lahary (bibliothécaire passionné ayant travaillé dans le 92 à Vanves puis dans le 95 au sein de la BDP95, membre du comité éthique de l’ABF et soucieux de faire connaitre la Loi Robert au plus grand nombre de professionnels) et Sophie Caillieux (présidente de Bib92).
Introduction (9h30-10h) de Dominique Lahary s’appuyant sur le diaporama suivant :
C’est une introduction de cadrage, Dominique revient sur la différence entre morale (la morale dépend des mœurs, on parle souvent de choc des morales) et éthique (la déontologie, l’ensemble de règles et de devoirs qui régissent une profession, émise soit par la loi ou par le décret, soit par une profession qui donne elle-même ses règles) comme dans le cas des bibliothécaires. Il aborde les notions d’éthique de conviction (j’agis suivant mes convictions) et d’éthique de responsabilité (je fais attention aux conséquences de mes actes) définies par Max Weber. Ces deux éthiques sont différentes mais il existe une contradiction entre les deux qui fait que les choses bougent (et heureusement !).
La Loi Robert définit les bibliothèques par leurs missions (assurer l’accès de tous à la culture, à l'information, à l'éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs) dans le cadre des principes de principes (pluralisme des courants d'idées et d'opinions, égalité d'accès au service public, mutabilité et neutralité du service public). La neutralité, obligation de l’agent public telle que définie dans le Code général de la fonction publique, c’est à la fois l’égalité de traitement des usagers et la non-exposition de ses opinions et croyances personnelles (l’agent n’est pas là pour faire la propagande de ses idées). En bibliothèque, elle se manifeste par le pluralisme, reconnu comme objectif valeur constitutionnelle.
En matière de politique documentaire, la loi Robert institue une délégation de responsabilités publiques aux bibliothèques puisque c’’est elle qui sont chargées d’élaborer les orientations générales de « leur » politique documentaire. Ce document, correspondant à ce qu’on appelle généralement la charte documentaire, par sa transmission au conseil municipal ou communautaire, doit être public puisqu’il exposer les principes et critères au nom desquels sont faits les choix des bibliothèques : acquisitions, non acquisition, désherbage. C’est à chaque équipe de l’élaborer, sans faire de copier-coller, il est normal que ces chartes ne soient pas absolument identiques d’un établissement à l’autre. La charte documentaire est à la fois un bouclier, une potection, et engage les professionnels. C’est une nécessité démocratique.
« Serait censure de la part de la bibliothèque ce que nous refusons selon des critères qui ne sont pas mentionnés dans la charte documentaire ».
Discussion (10h-12h) :
1) Qualification des auteurs
Faut-il tenir compte de qui est ou qu’a fait un auteur ou s’en tient on au principe de séparation entre la personne et son œuvre ? Sa personnalité transparait-elle toujours à travers ses écrits ? La discussion contradictoire a permis d’évoquer de nombreux auteurs, de François Villon à Louise Bourbeau en passant par Céline mais aussi l’Abbé Pierre.
Indication de Dominique : si un bulletin de moralité est exigé pour entrer dans la collection quelle que soit l’œuvre concernée, alors ce doit être inscrit explicitement dans la charte documentaire, ce qui semble difficile.
2) Politique
Débat autour des périodiques : il est question de savoir jusqu’où aller dans la recherche de l’équilibre entre tous les bords politiques. Les bouquets de presse en ligne permettent un large éventail apprécié par une partie des participants et ils peuvent compenser les contraintes budgétaires. Des usagers peuvent s’étonner de la présence ou de l’absence de tel ou tel titre ce qui peut permettre de compléter ou non la liste des abonnements. Sur les ouvrages relevant de la politique nationale, certaines équipes excluent les livres ou programme de candidats et renvoient vers la presse l’actualité immédiate, d’autre non.
Indications de Dominique : La bibliothèque se doit d’être une vitrine de la République et non ce qui convient absolument à chacun. En cas d’alternance politique, l’idéal est que le nouvel exécutif, consultant la liste des abonnements et la charte documentaire, n’y trouve rien à redire.
3) Information et communication
L’information, auparavant filtrée par les tiers identifiables que sont les éditeurs et les organes de presse, circule désormais également sur le web et par les réseaux sans que les récepteurs puissent qualifier la fiabilité de son origine. Mais la problématique générale est plus ancienne, comme en témoigne l’ouvrage d’Edward Bernay Propaganda : comment manipuler l’opinion en démocratie paru pour la première fois en 1928 https://www.editionsladecouverte.fr/propaganda-9782355220012. C’est l’enjeu de l’EMI (éducation aux médias et à l’information) d’aider tout un chacun à prendre du recul par rapport aux informations qui lui parviennent. Les bibliothèques sont reconnues comme un des acteurs de l’EMI.
Indications de Dominique : en mentionnant l’égal accès à l’information dans les missions des bibliothèques, la loi Robert justifie leur implication dans l’EMI. Personne ne peut personnellement juger des informations qui lui parviennent en mettant sur le même plan ce qui relève d’une enquête journalistique ou d’une méthodologie scientifique avec des contenus relevant de manipulations conscientes ou inconscientes. L’esprit critique ne consiste pas à faire son choix entre des contenus hétéroclites mais à savoir qualifier les tiers de confiance.
4) Sciences et techniques
Deux solutions s’expriment à propos des ouvrages dont la scientificité n’est pas établie, voire qui relèvent de croyances et non d’une démarche proprement scientifique : les écarter au nom de la mission d’accès à l’information et aux savoirs (loi Robert) ou ne pas les classer en sciences et techniques mais dans des rayons Société ou Croyances ? Cette question a été particulièrement vive à propos des vaccins contre la Covid19 mais concerne aussi certaines pratiques se réclamant de la santé, le point limite étant lorsque le recours à la médecine est découragé ce qui met en danger les patients (éthique de responsabilité). Le rythme de désherbage de ces documents peut être lié à l’extinction d‘un effet de mode tandis que les documents scientifiques sont dépendants des évolutions de la recherche. Que faire des demandes redondantes inscrites sur le cahier de suggestions ? Doivent-elles faire l’objet de quotas par mois (2 par exemple) lorsqu’un usager en propose trop régulièrement et abondamment ? Certains participants imaginent de créer des réponses types aux suggestions afin de normaliser les réponses faites aux usagers.
Indications de Dominique : Les réponses orales ou sur le cahier de suggestions doivent pouvoir s’appuyer sur les critères énoncés dans la charte documentaire. Bien prendre en compte le fait que les personnes qui s’expriment oralement ou par le cahier de suggestion sont une minorité pas forcément représentative ; il faut essayer d’être également ouvert aux besoins et aspirations des usagers silencieux. En matière d’éthique de responsabilité, on peut faire la différence entre les contenus dangereux et ceux relevant éventuellement de l’effet placebo.
5) Religions, croyances
Chacun convient qu’une présentation équitable entre différentes religions sans en privilégier aucune. Toutefois, il existe un déséquilibre dans l’offre éditoriale en la matière. Est évoquée une distinction possible entre des ouvrages sur les religions et les ouvrages prosélytes. Les ouvrages sur des sujets tels que la mort imminente ou les médiums peuvent être classés en Croyances.
Indications de Dominique : Prenons garde aux libellés de la classification Dewey qui ne sont guère appropriés, comme « Autres religions ». Il est conforme à la laïcité que la bibliothèque prenne chaque religion comme un fait social (concept du sociologue Emile Durkheim) ayant sa place à ce titre dans les collections. La notion de croyance évolue : l’article premier de notre Constitution datant de 1958 proclame que la République « respecte toutes les croyances », on ne pensait alors probablement qu’aux religions proprement dites.
6) La fiction
Le débat se concentre sur le phénomène littéraire de la dark romance. D’un côté, des membres de nos équipes ne sont pas à l’aise avec cette littérature prisée par des adolescentes en présentant des contenus problématiques et suivant dégradantes pour les femmes et n’imaginent pas les promouvoir. De l‘autre, on peut considérer qu’il s’agit de fiction relevant donc de l’imaginaire, éventuellement du fantasme, de l‘interdit, du tabou social, alors que par ailleurs beaucoup d’adolescents ont accès à la pornographie. Certaines équipes restreignent l’emprunt à partir d’un certain âge (15 ans) et rangent cette littérature en section pour adultes. Est brièvement abordé la question des romans de type Harlequin et ses successeurs que d’un certain point de vue on peut juger de médiocre qualité littéraire.
Indications de Dominique : La dark romance est un phénomène de masse, l’ignorer en bibliothèque est impossible même s’il y a différentes façons de le gérer. Si un agent ne veut pas promouvoir un « document sensible », ce n’est pas grave, on n’est pas obligé de promouvoir tous ce qui figure dans la collection. Ce genre romanesque et d’autres comme la littérature sentimentale pour adultes conduit à considérer la notion de droits culturels mentionnée par la loi Robert : chacun est porteur de ce qui fait culture pour lui. On peut également se demander pourquoi les gens lisent, ce qu’ont étudié les sociologues Gérard Mauger et Claude Poliak qui ont distingué la lecture de divertissement, la lecture didactique, la lecture de salut et la lecture esthète. Toutes ces lectures sont légitimes et y doivent faire partie du service public.
Deux remarques générales sur la politique documentaire :
Un participant a mentionné, outre la charte documentaire, le plan de développement des collections (PDC). Cet outil précis de mise en œuvre de la politique documentaire ne fait pas partie de ce que la loi Robert mentionne comme devant être transmis à l’assemblée délibérante.
Il existe une idée reçue selon laquelle les bibliothécaires en fonction de leurs goûts et opinions. Ce serait une attitude non professionnelle. La charte documentaire, si elle est rendue publique, manifeste qu’il n’en est rien.
Conclusion :
Dominique reprend l’expression de Denis Merklen « La bibliothèque se doit d’étonner et, parfois, d’importuner. C’est à ce prix qu’elle se montre émancipatrice. » ; Il est normal que l’éventail proposé choque telle ou telle personne dans le public ou dans l’équipe de la bibliothèque, on peut même dire que si ça n’arrive jamais c’est louche. Sophie Caillieux conclue en reprenant la citation de Dominique : « ce qui est mis par une bibliothèque à destination du public ne peut être l’ensemble de ce qui ne choquera personne ni dans l’équipe, ni dans le public ».
Pour continuer à se former sur ces thématiques :
-Médiadix et la Médiathèque de l’Essonne mettent en place une formation : les fondamentaux du métier de bibliothécaire territorial (https://www.crfcb.fr/#/program/paris)
-le comité d’éthique de l’ABF (https://www.abf.asso.fr/4/119/242/ABF/comite-d-ethique)
-le blog professionnel de Dominique Lahary (https://lahary.wordpress.com/) et son site internet (http://lahary.fr/pro/)
-le Code général de la Fonction publique, livre I sur les droits et obligations https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000044416551/LEGISCTA000044420599/
-le Code de déontologue des bibliothécaires publié par l’ABF https://www.abf.asso.fr/6/46/78/ABF/code-de-deontologie-des-bibliothecaires
-la loi Robert et son mode d’emploi publié par l’ABF https://www.abf.asso.fr/6/214/984/ABF/mode-d-emploi-de-la-loi-robert-sur-les-bibliotheques-territoriales
-les usages sociaux de la lecture définis par Mauger et Poliak (https://www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1998_num_123_1_3252
-les bibliothèques : ponts et porte à la fois, conférence de Denis Merklen, dans le livre électronique de l’Enssib en libre accès: https://presses.enssib.fr/catalogue/bibliotheques-portes-et-ponts-la-fois
-laïcité et fait religieux dans les bibliothèques, rapport de l’inspectrice générale Françoise Legendre https://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/68543-lacite-et-fait-religieux-dans-les-bibliotheques-publiques