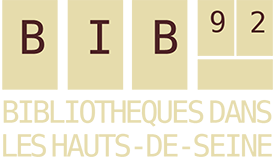Le point sur... : la constitution d’une communauté de cinéphiles en médiathèque
Cette matinée a eu lieu le jeudi 17 octobre 2024 à la Bibliothèques Les Violettes de Courbevoie et était animée conjointement par Eric Mallet de Puteaux et Jean-Yves de Lépinay.
« Le cinéma a besoin que l’on parle de lui. Les mots qui le nomment, les récits qui le racontent, les discussions qui le font revivre, modèlent sa véritable existence. [...] Aller au cinéma, voir des films, cela ne se comprend pas sans ce désir d’en prolonger l’expérience par la parole, la conversation, l’écriture. Chacune de ces remémorations donne au film sa vraie valeur ». Antoine de Baecque.
3 points ont été abordés :
1 ) l’importance du lien social pour contrer ce que les États-Unis appellent « l’épidémie de solitude »
Les médiathèques peuvent ainsi jouer le rôle de socialisation des solitudes. Un extrait d’une émission avec l’économiste Eloi Laurent a été diffusé.
2 ) Comment définir la cinéphilie ?
Selon Antoine de Baeque la cinéphilie est avant tout une passion, certes, mais une passion qui est aussi une culture, c’est-à-dire un discours. Cet essor du discours sur le cinéma entraîne la légitimation culturelle d’une production longtemps méprisée tout en intégrant en son sein les grands courants de pensée politiques, artistiques ou philosophiques de son temps.
Jean-Yves de Lépinay a distingué deux types de cinéphilie :
L’une est entretenue par la Cinémathèque Française, véritable institution, une cinéphilie essentiellement axée sur l’analyse esthétique et formelle des films avec bien souvent le seul prisme de la question de l’auteur réalisateur. Cette cinéphilie est considérée pour certains comme déconnectée des enjeux d’aujourd’hui.
L’autre procède à une relecture des films telle que le pratique le Forum des Images à travers une sélection thématique en lien avec une évolution de la société.
Plusieurs types de cinéphilies peuvent coexister :
Une nouvelle génération peut avoir une approche ciblée sur certains aspects du cinéma (exemple : le cinéma japonais de genre des années 60/70), des aspects qu’elle maitrise complétement en occultant des cinéastes considérés comme majeurs par certains historiens du 7e art.
3 ) Constituer une communauté de cinéphiles en médiathèque
Exemple : les Rencontres Cinéma de Puteaux
Texte publié dans le Médiathème « Cinéma en bibliothèque »
Depuis 2004, les bibliothèques de Puteaux accueillent une à deux fois par mois un rendez-vous autour du cinéma, « Les Rencontres Cinéma ». Leur modèle tranche radicalement avec les séances-rencontres traditionnellement proposées au public. Ici, aucun film n'est projeté en intégralité. Aucun membre de l'équipe du film n'est présent pour échanger avec les spectateurs. Un thème est défini plusieurs mois à l’avance et permet de traiter d'un cinéaste (Maurice Pialat, Lars Von Trier), d'un acteur (Ryan Gosling, Patrick Dewaere), de la cinématographie d’un pays (Corée, Argentine), d’une ville (Londres, Marseille) ou encore d'un problème de société (le monde du travail à l’écran, cinéma et psychanalyse). Le documentaire, les séries télévisées ou encore les événements de la Cinémathèque, expositions ou rétrospectives, peuvent aussi faire l'objet d'une séance.
Quand le sujet est défini, 5 ou 6 films sont sélectionnés, en priorité des œuvres disponibles dans le fonds DVD de la médiathèque. Le public est invité à visionner les films avant la soirée, et je repère plusieurs intervenants, choisis parmi les bibliothécaires ou les adhérents, pour prendre la parole à l'occasion des Rencontres. En introduction, l'un d'eux, plus spécialisé sur le sujet, effectue une rapide présentation générale ; puis, pour chaque film, une personne différente présente l’œuvre en moins de 10 minutes, en rappelant quelques éléments clés du film (l'intrigue, les acteurs, le réalisateur), et en s’efforçant de contextualiser l’œuvre à la fois dans les courants de son époque et dans la filmographie du cinéaste. L'intervenant doit ensuite exprimer son ressenti. Souhaite-il le conseiller ? Et si oui, à quel public ? Le but de ces rencontres est donc avant tout de transmettre l’envie de voir un film (ou de ne pas le voir) en donnant davantage de place aux émotions, à la subjectivité, plutôt qu'à une pure analyse filmique et intellectuelle.
Ainsi, à travers cette animation, des liens se créent entre les participants. Le besoin d’échanger perdure bien après la séance et il n’est pas rare de voir plusieurs participants rester discuter devant la médiathèque jusqu’à une heure avancée et échanger leur numéro de téléphone avant de se quitter. Ces passionnés n’ont qu’une seule hâte ensuite : celle de se retrouver lors d’une prochaine manifestation. Ils se sentent appartenir à une communauté.
« Parler, échanger, c’est construire des regards, des visions politiques, l’envie de partager un monde ensemble. Ainsi il convient de construire des espaces pour faire émerger cette parole et ces échanges de manière collective. » Dominique Rousselet.