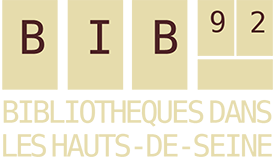Commission Petits éditeurs BiB92 - Sélection mars 2025
Sélection de mars 2025 téléchargeable sur le site : cliquez ici
Accès direct aux critiques ci-dessous
En Amérique, en 1957, nous faisons la connaissance d'un couple ordinaire, Kathleen et Virgil Beckett. Depuis six mois, ils vivent avec leurs deux enfants à "Acropolis Place", une résidence située dans la banlieue de Newark, dans le Delaware. Tous les dimanches, cette petite famille "bien comme il faut" se rend à l'église. L'après-midi, Virgil joue au golf avec ses collègues. Un dimanche de novembre étonnamment chaud, Kathleen décide de se baigner dans la piscine de la résidence… Et de ne plus en sortir. Par ce geste radical et insolite, elle espère provoquer un changement dans la situation figée de son couple. À travers des allers-retours entre présent et passé, nous découvrons peu à peu les secrets et les mensonges qui minent cette relation... Afin d'accentuer son sentiment d'enfermement et d'étouffement, Kathleen se compare à Laïka, cette petite chienne envoyée dans l'espace en 1957, dans une minuscule capsule sans retour possible. L'autrice réussit ainsi à mêler l'actualité de l'époque tout en déroulant l'histoire de ses principaux protagonistes. Un roman à la construction narrative intrigante : les retours dans le passé distillent les révélations avec habileté, maintenant une tension latente. À travers ses personnages, l'autrice dresse un portrait de la société américaine des années 50, où les apparences priment et où chacun porte son lot de mensonges. Un récit où il ne se passe pas grand-chose et qui peut laisser une impression de lenteur. Cependant, la dissection des rapports conjugaux est intéressante et les descriptions psychologiques assez réussies.
Anthony, Jessica. - Nage libre. - Le Cherche Midi. - Traduit de l’américain. - 139 p. - 18 €
En 1992, la narratrice, Delphine Maugein, sorte de double de l’autrice, obtient un poste de bibliothécaire à l’université des sciences de Strasbourg. Elle achète un appartement où elle fait la connaissance posthume d’Emma, concierge de l’immeuble dans les années 30 et évacuée en 1939. A travers le destin de cette inconnue, elle mène une enquête sur le destin de ce personnage et sur les habitants de cet immeuble. A partir de ces vies simples, l’autrice retrace l’Histoire de cette ville, de cette région à la veille, pendant et après la Seconde Guerre Mondiale. « Si les circonstances sont imaginaires, comme le précise une longue note en fin de volume, où Michèle Audin dit quelles ont été ses sources, tout a été inspiré par des réalités historiques. En outre, l’autrice connaît bien Strasbourg, où elle a été professeure de mathématiques de 1987 à 2014. » Elle est également une spécialiste de la Commune de Paris. Cet ouvrage très documenté m’a plongé avec passion dans cette période hallucinante qu’ont connu les Alsaciens, annexés par l’Allemagne nazie.
Audin Michèle. - La maison hantée. - Minuit. - 197 p. -. 19 €
“Cha” est le sobriquet de Sébastian “Chano” Rodrigues, champion paralympique de natation qui obtint pas moins de cinq médailles aux J.O. de Sydney. Il connut une carrière sportive exceptionnellement longue et brillante. Hors normes “Cha” l’est à bien d’autres titres. S’il a perdu ses jambes, ce n’est pas dans un accident de la circulation comme il le déclara aux responsables espagnols lors des JO, mais à la suite d'une grève de la faim de 432 jours. Membre du GRAPO, une organisation terroriste d’extrême gauche très active en Espagne entre 1975 et 1985, il fut condamné à 84 ans de prison pour participation à diverses attaques et le meurtre d’un entrepreneur sévillan. La découverte de son passé et de son engagement fit polémique, mais jamais il ne s’en expliqua et fut amnistié en 2007. Ce silence que souligne le titre du récit, c’est celui qu’a tenté de percer Ivan Butel. Le premier livre de ce documentariste est passionnant par la peinture intimiste qu’il brosse de la fin du franquisme et de la difficile transition démocratique qui s’ensuivit. Jamais Ivan Butel ne se montre complaisant ou accusateur, malgré l’amitié qui naît entre les deux hommes. Pendant vingt ans, il a essayé de comprendre le parcours de cet homme “sombra y luz”.
Butel, Ivan. - De silence et d’or. - Globe. - 249 p. - 22 €
« En Asie, dans les années 1970, Charles Sobhraj (dit le serpent) droguait, volait et tuait des jeunes voyageurs étrangers. J’ai eu la malchance de le croiser et de le subir. Ce livre est une histoire vraie, inspirée de cette rencontre. ». Charles Sobhraj, né à Saigon, beau gosse aux manières policées et tueur en série de voyageurs, chasse ses proies dans les grands hôtels. Les victimes favorites de ce personnage machiavélique sont de jeunes hippies parcourant l'Asie à la recherche de drogue et de spiritualité. Celui que l'on a surnommé le Serpent a été reconnu coupable d'une douzaine de meurtres et soupçonné d'une vingtaine d'autres assassinats. Le couple s'élance avec leur chien à bord de sa Dodge aménagée rejoindre le Bhoutan. Mais lors du trajet, leur véhicule est visé par une balle. Ils n'atteindront jamais leur but, ils trouvent refuge à Peshawar, dans un hôtel de légende issu de la splendeur victorienne, l'hôtel Dean's. Mais tout n’est pas idyllique : on croise des routards sans le sou, livrés dans des hôtels crasseux à la maladie et à la drogue. Leur rencontre avec Joël Phong, ingénieur, n’est pas fortuite. L’homme cherche à devenir leur ami, mais il faut attendre plus de 100 p qu’il finisse par empoisonner le couple et leur chien, pour tout leur voler. Il aura suffi de deux verres frelatés pour que le plan machiavélique conçu par cet « ami » fonctionne et basculer dans le drame. « La honte résonnant encore plus fort que la haine. » (p 128) L’auteur regrette amèrement de ne rien avoir pressenti du drame qui les guettait. « En son domaine, c’était un virtuose. Un manipulateur et un menteur pair. » (p 133). Petit roman avec peu d’action, mais l’auteur s’attache à tout décrire précisément dans ce voyage « exotique » très couleur locale, où seul l’hôtel est un havre de verdure et de sécurité, à l’inverse du reste du pays. Malgré de bonnes critiques, je n’ai pas été captivée par cette histoire véridique.
Debayle, Céline. - Dans le jardin de l’hôtel Dean’s. - Arléa, 1er mille. - 143 p. - 19 €
« Ootlin », en écossais, désigne une personne qui ne trouve pas sa place. Ces mémoires ont mis 20 ans à émerger, à partir de ses journaux intimes tenus depuis son enfance et des documents administratifs qui l’ont suivi. Récit autobiographique divisé en 3 parties : de 0 à 5 ans, de 5 à 12 ans et de 12 à 16 ans (presque la ½ du livre) L’autrice raconte sa naissance malgré une grossesse non désirée, une mère droguée et des aïeuls fous ou ivrognes, bref de quoi bien débuter dans la vie. Elle est aussitôt confiée à l’Etat, « je savais (...) qu’il n’y aurait jamais de véritable foyer pour moi sur cette planète ». (p 34) Elle aura 19 noms différents suivant les dossiers, enchaînera déménagements, familles d’accueil ; elle sera maltraitée même si elle est suivie par les services sociaux. « Pendant toute mon enfance passée en structures d’accueil, on m’a bourré le crane pour me faire croire que j’étais une sorte de monstre... » (p 18) Il semble inévitable que Jenni soit tombée dans la délinquance dès le plus jeune âge : suicide, overdose, fugue, rébellion, viols. Elle dénonce ce qu'elle a subi dans des structures de "protection de l'enfance" : mauvais traitements, violences physiques et verbales, humiliations. Dès 8 ans, elle écrit des poèmes et rêve de devenir écrivaine. Elle fait une tentative de suicide, mais ne perd pas espoir :« Des fois je suis folle de joie à l’idée d’être vivante parce qu’un jour je ferai quelque chose de génial. Je ne serai pas toujours une cassos. » (p 91) Malgré ce parcours destructeur, elle a su se relever. Il a fallu une force inouïe pour s’en sortir, grâce à la musique et l'écriture. Jenni est attachante, rebelle et généreuse. Elle soulève des questions sur la maltraitance, les abus, les dominations... et met en lumière l’importance de la bienveillance, du non jugement. C’est l’histoire aberrante de l'auteure, qui scandalise car elle se passe dans un temps récent. C’est cru et très noir, mais on poursuit la lecture car on sait que l’autrice s’en est sortie.
Fagan, Jenni. - Ootlin. - Métailié. - Traduit de l’anglais (Ecosse). - 368 p. - 23 €
Dans ce livre, s’entrecroisent deux récits, celui de Valentina, l’une des premières femmes médecin dans le Chili des années 50 et celui de Luis, jeune Havrais qui apprend au décès de sa mère en 1998, que son père est un disparu de la dictature de Pinochet. Valentina est une femme indépendante qui choisit de soigner les travailleurs des estancias, malgré les mauvaises langues qui disent que la Patagonie n’est pas faite pour une femme. Elle est accompagnée pour quelque temps de Tcefayek, la dernière survivante des Kawésqars, un peuple premier massacré par les colons. Luis, lui, rejoint la Patagonie à la recherche de ses racines. Avec son oncle, il apprend à monter à cheval et à vivre comme un gaucho. Ce roman d’aventures mêle l’Histoire du Chili et de la Patagonie à travers une nature aussi sublime qu’impitoyable. Une ode à la liberté.
Grouès, Delphine. - Les braises de Patagonie. - Le Cherche midi. - 245 p. - 21 €
Elisabeth, grand-mère juive ukrainienne, habite en Australie. Dans sa jeunesse, elle a traversé seule la guerre (père, frères et sœurs morts) grâce à un physique aryen et une très bonne connaissance de l’allemand. Elle invite sa petite fille française à la rejoindre (la narratrice) passer des vacances en sa compagnie dans les Alpes australiennes. Sur place, Elisabeth a établi une relation avec Carl, Allemand de 84 ans, qu’elle sait être un ancien SS. Afin de se venger (et toutes les victimes de la Shoah) elle espère l’éliminer, avec l’aide de sa petite-fille ; elle a déjà élaboré un plan. C’est ce plan que nous allons découvrir, en même temps que la narratrice, entrecoupé d’éléments historiques qu’a vécu Elisabeth, au long de sa vie et de la guerre. C’est une histoire certes rocambolesque que nous lisons et la surabondance d’adjectifs destinés à magnifier l’écriture plombe un peu le style. Néanmoins, ce roman a un intérêt certain et peut plaire : au fil des vies successives d’Elisabeth qui nous sont racontées, nous avons un aperçu dans plusieurs pays (Ukraine, Roumanie, Pologne…) de la solution finale instaurée par le régime nazi et du martyr du peuple juif.
Hazan, Carine. - Vies et survies d’Elisabeth Halpern. - Phébus. - 237 p. - 21 €
Sarah Jollien-Fardel nous raconte l'histoire de Rose, qui trois ans après la mort tragique de sa fille, se retrouve recluse dans une chambre, attachée à une longe par son mari qui tente désespérément de la protéger. Chaque jour, Rose revisite son passé : en cherchant à comprendre les circonstances de l'accident de sa fille, elle se remémore son enfance dans un village valaisan, la perte de sa mère, sa rencontre avec Camil, son ami d’enfance, devenu son mari et les moments avant le drame. Au fil de ses réflexions, elle tente de déceler les failles qui l'ont conduite à cette situation. Un jour, la présence d’une personne inconnue derrière sa porte lui lisant à voix haute des textes littéraires lui laissent entrevoir un léger espoir, elle comprend qu’elle n’est pas seule dans sa souffrance. L’autrice aborde avec une grande sensibilité le thème de la résilience face à la perte. À travers le personnage de Rose, elle explore la profondeur de la douleur maternelle et la quête de sens après une telle tragédie. Ce roman, dont Rose est la narratrice est construit en deux parties à la 1ère personne du singulier entrecoupé d’un « aparté » où la narration passe à la 2ème personne, ce qui peut paraître un peu déstabilisant. L'écriture est à la fois délicate, lumineuse et introspective, elle offre le portrait touchant d'une femme en proie à ses démons et à sa douleur. Ce roman invite à une réflexion profonde sur le deuil, la culpabilité et la capacité humaine à surmonter la détresse et l’inconcevable. Quant à la longe, elle symbolise l'attachement à la souffrance et le contrôle, tout en suggérant la possibilité d'une libération. Une lecture émouvante et surtout éprouvante qui, malgré tout, apporte une lueur d’espoir.
Jollien-Fardel, Sarah. - La longe. - S. Wespieser. - 153 p. - 18 €
Mister Chance entretient le jardin de son patron, puis regarde la TV le soir. Il vit en huis clos, incapable de côtoyer le « vrai » monde. Quand le propriétaire décède, son univers s’écroule. Cet homme a vécu et travaillé ici toute sa vie ; il n’a jamais reçu de salaire, seulement été logé et nourri. Renvoyé et à peine dans la rue, notre « héros » se fait renverser par une voiture. Mme Rand le soigne, puis l’héberge. Son mari reçoit le Président et lui fait rencontrer Mr Chauncey Jardin. Il devient alors la personne qu'il faut connaître : les propos du jardinier deviennent paroles d'évangile pour le monde économique, politique, médiatique et cet homme simple devient celui que tout le monde s'arrache. Il doit passer à la TV pour commenter les idées du président, dont il n’a bien sûr aucune idée, il ramène tout au jardin et parvient à retourner la situation en sa faveur. Ne saisissant pas les subtilités des relations humaines, il répond aux questions au premier degré, aussi rafraîchissant que déconcertant. C'est amusant de voir cet homme qui énonce de simples vérités et que les gens transposent. Il parvient même à cacher qu’il est illettré. Sa vie prend un tour complétement inattendu. L’auteur utilise le personnage de ce Candide moderne pour se moquer des dirigeants, d'une société d’écrans et des médias, montrant comment elles façonnent la réalité. Kosinski dénonce l'absurdité d'un monde où les apparences priment sur la réalité. Il met en lumière l'absurdité d'un système où la communication est dévoyée et où les individus sont prêts à tout pour maintenir l'illusion du contrôle. Chance devient le miroir dénonçant la superficialité, manipulation des masses par les médias, et quête de sens. Le roman invite à une réflexion sur notre société. Lecture sympathique et originale. C’est très facile à lire et fluide. Satire intemporelle qui continue de résonner avec une étonnante actualité.
Kosinski, Jerzy. - Bienvenue Mister Chance. - Typhon. - Traduit de l’américain. - 176 p. - 20 €
De Douai à la Guadeloupe en passant par Bordeaux, Paris, Bruxelles, Lyon ou Rouen, récit de la vie de Marceline Desbordes-Valmore, poétesse itinérante et comédienne accomplie. Sa rencontre avec Prosper Valmore est déterminante. Premier à croire en elle, il lui donne la possibilité d'accomplir son rêve, écrire, et devient son époux et sa boussole. Marceline est une femme engagée, courageuse et très indépendante pour son époque malgré les nombreux drames familiaux qui ont jalonnés son existence. Ce roman est une biographie intéressante d’une poétesse peu connue, pionnière du romantisme et admirée par ses pairs : Balzac, Verlaine ou encore Baudelaire. Il se lit facilement même si je l’ai parfois trouvé un peu classique dans sa forme : un enchainement chronologique des différentes étapes de sa vie. Cependant, ce livre permet de découvrir les poésies romantiques et passionnées de Marceline.
Lapertot, Céline. - Des beaux jours qu’à ton front j’ai lus. - V. Hamy. - 256 p. - 22 €
Marie et Georgine sont deux sœurs qui vivent ensemble dans la maison que leur père, un notaire récemment décédé, leur a laissée. Marie, âgée de 31 ans, est l’aînée. Lorsque Georgine est née, 20 ans plus tôt, elle a développé un sentiment de haine à son égard. Mais, alors que Georgine n’avait que deux ans, leur mère est décédée. Marie est alors devenue une vraie grande sœur, voire une véritable maman, pour Georgine qui se repose depuis entièrement sur elle. Luc Hanq, un voisin qu’on dit coureur de jupons, marié à une femme plus âgée et malade, leur offre une arme de sa collection afin qu’elles se protègent maintenant qu’elles sont seules à la maison. Il leur donne même des leçons de tir et vient les voir régulièrement, devenant vite un visage familier dont elles ne peuvent bientôt plus se passer, totalement sous le charme de cet homme qui aime plaire. Quand la femme de Luc Hanq meurt, elle fait de lui un veuf très convoité. Il s’agit d’un récit plutôt classique et bien écrit. A noter que la description de la société de l’époque et la place que prend la rumeur dans un petit bourg sont particulièrement bien vues. Mais c’est dans la fine analyse des sentiments des deux sœurs que réside tout l’intérêt du livre, le transformant en véritable suspense.
Loveling, Virginie. - Un coup de revolver. - Cambourakis. - Traduit du néerlandais. - 220 p. - 22 €
A Kamakura, Hatoko, la narratrice, reprend après une dizaine d'années son métier d’écrivain public à la papeterie Tsubaki -ou camélia-, après avoir élevé ses enfants. Elle jongle entre son rôle de mère, de femme et de propriétaire de la papeterie. Elle a appris la calligraphie auprès de l’Ainée, sa grand-mère, toujours présente à travers des souvenirs. Hatoko nous raconte sa vie de famille et son quotidien, à aider ses clients à résoudre des conflits ou à communiquer grâce à des lettres, pour ceux qui ne parviennent pas à rédiger leurs lettres d'amour, d'adieu ou de réconciliation. Hatoko mène une vie paisible mais a également des doutes, des craintes, ses peines face au rejet de QP, sa fille. Elle a du mal dans ces relations avec un mélange de tension et de tendresse, simple crise d'adolescence ou douleur plus profonde ? Comment être à la hauteur, trouver son équilibre, une harmonie entre vie personnelle et professionnelle, son statut de mère et sa féminité ? Elle nous décrit les nombreux plats ou pâtisseries qu’elle déguste par exemple avec du thé Marco Polo de chez Mariage, ces dégustations nous paraissent plus présentes que les passages consacrés à son activité d’écrivain public. Description précise du papier, de l’encre et de la calligraphie utilisés. Récit interrompu par les reproductions de textes en VO ou des caractères. Tout est traité avec délicatesse et pudeur. On la suit, immergés dans une culture japonaise pleine de poésie et de saveurs. La plume de l'autrice est délicate et subtile. Une lecture apaisante, parfaite pour les amateurs de lenteur poétique. COUP DE COEUR PAGE DES LIBRAIRES !
Ogawa, Ito. - Lettres d’amour de Kamakura (La papeterie Tsubaki, vol. 3). - Picquier. - Traduit du japonais. - 368 p. - 23 €
Blaise et Iris sont les deux anti-héros de ce dernier roman, « deux beaux ratés côte à côte, revigorant », tous deux mal intégrés à leur famille. Elle est standardiste et se retrouve nue sur un toit, soupçonnée de vouloir se suicider ; lui est chauffeur de VTC, mais mauvais conducteur. Ces deux êtres se rencontrent, puis se retrouvent ensuite par pur hasard. Ils forment alors un duo de choc, épris de liberté, décidés à échapper à leur vie minable et aux normes de la société. Ils emménagent ensemble dans une maison en ruine au bord de la Manche, en zone blanche, et survivent en volant dans les commerces. Leurs familles jusqu’ici peu présentes vont tout faire pour les récupérer et les remettre dans le droit chemin, tentatives aussi infructueuses que comiques. L’humour de F. Vallejo est stimulant, l’auteur s’amuse de situations absurdes, cocasses et décalées. Il joue avec les mots et les analogies. Il met en scène un épisode mémorable où les personnages se retrouvent tous ensemble dans la ruine : son style mime avec virtuosité leurs déraillements verbaux sous l’emprise du champagne. Le lecteur s’interroge : comment faire pour échapper aux normes sociales étouffantes ? Il se demande aussi qui est le plus fou dans cette histoire, ces deux asociaux ou bien les gens « normaux » qui prennent en vidéo une femme prête à se suicider pour faire le buzz ?
Vallejo, François. - Cet étrange dérangement. - V. Hamy. - 295 p. - 21 €
Paris 1893, une bicyclette est exposée dans une vitrine, « vendue à Mr Zola ». C’est la seconde personne à acheter ce modèle anglais à deux roues égales de marque Rudge à 1000 francs, représentant la « haute technologie de son époque » (p. 16). Zola à vélo ? la Rudge va le conquérir, comme le tout Paris. Cette nouvelle passion charme ses proches, ses amis. Zola commande un modèle de femme pour sa maîtresse. Suite à cet achat, il devient la coqueluche de la presse qui veut l’interviewer. L’écrivain compte sur ses vertus thérapeutiques pour se sentir mieux. Il apprend à faire du vélo dans un manège à l’aide d’un professeur : « je fus très long à apprendre à me tenir convenablement en équilibre. C’est pour monter sur la bicyclette, surtout, que ce fut le diable… » (p. 38). « je suis devenu un enragé du bicyclisme » (p.40). L’écrivain est persuadé que ce mode de transport non polluant va connaître un succès fou. La bicyclette est une véritable révolution dans les mœurs. Cette histoire des débuts du vélo permet aussi de retracer des moments biographiques de Zola et un portrait de l’époque. L’engouement pour la bicyclette se répand dans toutes les classes sociales. On court voir les nouveaux modèles, rois et reines ou le tsar Nicolas II ne sont pas épargnés par cet engouement. Il touche aussi les femmes, en libérant leur corps. La bicyclette servira-t-elle l’émancipation des femmes qui doivent porter un pantalon pour rouler ? L’Amérique bâtit des usines pour produire 50.000 machines. Flammarion se plaint qu’on emporte maintenant en vacances sa bicyclette au lieu de livres ! Livre au ton plein d’humour, illustré de caricatures, photos et de nombreuses références d’articles d’époque. Je ne m'attendais pas à être passionnée. Pas besoin de faire du vélo pour être pris dans cet essai historique très instructif, amusant et inattendu. Page turner à dévorer en roue libre en écoutant Montand ! Une belle découverte !
Vespini, Jean Paul. - Zola à bicyclette : libre et dans le vent. - Arthaud. - 283 p. - 20 €